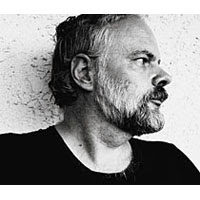Ces cahiers entament comme vous l'aurez judicieusement noté une phase de métamorphose tâtonnante après une trop longue période d'
estivation silencieuse due sans aucun doute au sort subi par mon petit cervelet fragile, tout engourdi par la surchauffe actuelle du jus tièdasse dans lequel il barbotte d'habitude à son aise.
Bref, pour vous aider à patienter en attendant la fin des travaux, je me résouds à republier ici ce que j'avais déjà pu écrire ailleurs sur un roman-monstre qui m'est cher,
La maison des feuilles. Cette initiative est d'autant plus superflue, je l'avoue sans vergogne, que vous n'aurez aucune chance de trouver ce livre chez votre épicier préféré : il est en "cours de réimpression" - comprenez que la
maison Denoël, détentrice des droits de publication en France, attend patiemment que la demande soit assez conséquente pour se décider à en refaire un tirage, ce qui est malgré tout compréhensible quand on connait le casse-tête éditorial dont il est question ici...
* Cependant, les bibliothèques ne sont pas faites pour les chiens, et vous pourrez toujours, si le coeur vous en dit après lecture de mon humble avis (TM), vous y rendre pour juger par vous-même! Et puis après tout, si vous avez une confiance aveugle en moi, ou tout simplement de l'argent à dépenser, vous pouvez toujours
contacter Denoël pour leur faire comprendre que vos 30 euros les attendent...
Addenda du 05/08 : D'après les informations glanées
ici sur le très recommandable
blog de g@rp,
La maison des feuilles renaîtra à nouveau de ses cendres pour la sortie du second roman de Danielewski (voir infra -
ce billet ressemble de plus en plus dans sa forme au livre qui en est le sujet... Contagion?). L'occasion ou jamais de vous le procurer! Reste ce grand point d'interrogation : la réédition sera-t-elle expurgée des coquilles de la VF originelle? Suspense, quand tu nous tiens.
 La maison des feuilles
La maison des feuilles s'ouvre sur une mise en garde : "Ceci n'est pas pour vous." Ce n'est pas tant une postulation élitiste qu'une sorte de couverture de l'auteur : "Si ce livre ne vous plaît pas, n'allez pas dire que vous n'étiez pas prévenu!" Et cet avertissement n'est pas tout à fait gratuit, car effectivement, ce livre ne s'offre pas à tout le monde. C'est un labyrinthe sur les labyrinthes, une bâtisse qu'il faut pouvoir défier, au risque de se perdre dans son épais feuillage. Dédale narratif, sémantique et typographique,
La maison des feuilles met tout en oeuvre pour égarer son visiteur. D'abord publié sur internet (sans ses annexes), cet (hyper)texte a mis plus de dix ans à se tisser dans le cerveau de son créateur. Ce n'est peut-être que le premier roman de Danielewski, mais c'est sans conteste un chef-d'oeuvre.
Cette
maison, c'est d'abord celle de Zampanò, un vieil aveugle solitaire et secret, entouré de ses seuls chats, que l'on retrouve mort chez lui, dans un appartement tapissé de centaines de pages griffonnées et noircies en tous sens, et dont une malle contient un manuscrit sibyllin. Cet étrange héritage, c'est Johnny Errand, un jeune tatoueur paumé de Santa Monica, hypersensible mais peu cultivé (son nom en V.O., "Truant" qualifie quelqu'un qui fait l'école buissonnière), qui va en assumer le poids. Epris d'une respectueuse fascination pour ce vieillard qui était son voisin, il décide de mettre en ordre son travail, essai austère, quasi-universitaire, et incroyablement érudit, tout en continuant en parallèle sa vie dissolue et ses errances sentimentales, lui qui souffre d'un amour inassouvi pour une strip-teaseuse surnommée "Pan-Pan". Puis surviennent les cauchemars.
Car ce dont parle l'ouvrage du vieux Zampanò, qui constitue le corps central de
La maison des feuilles, c'est d'un légendaire film documentaire, le
Navidson Record, dont l'existence même n'est pas attestée, et qui a(urait) pour sujet principal une autre
maison, très ancienne, celle d'Ash Tree Lane (Virginie), où s'installent Will Navidson et sa petite famille. Tout semble commencer comme dans un téléfilm M6 : Will Navidson (Navy pour les intimes), photo-reporter dont l'une des prises de vues a été couronnée par le prestigieux prix Pulitzer, décide de prendre, pour leur installation dans la vieille bâtisse campagnarde, une année sabbatique auprès de sa femme Karen, une ex-mannequin magnifique et leurs deux enfants modèles, Chad et Daisy. Et d'immortaliser sur pellicule, par la même occasion, cette parenthèse bénie dans leur vie mouvementée.
Malheureusement, ce joli rêve de tranquillité se fissure quelque peu lorsque Navy découvre un jour, en rentrant de voyage, qu'il y a un nouveau placard -vide et obscur- dans la chambre des enfants et réalise, en prenant des mesures, que sa
maison est d'un quart de pouce exactement
plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, pour le lecteur comme pour ses habitants, la demeure de Ash Tree Lane semble soudain surgir d'un roman de Stephen King ou un dessin d'Escher, prendre vie, devenir une aberration terrifiante, quelque chose qui
ne devrait pas exister.
L'histoire du
Navidson Record devient au fil du récit une machine folle, à laquelle répond en écho, depuis ses notes de bas de pages de plus en plus envahissantes, l'histoire de Johnny, qui se penche sur le passé de Zampanò et sur son propre passif familial enfoui et terriblement douloureux. Et peu importe, à ce moment, que le reportage soit inexistant, tout comme nombre des références bibliographiques données par le vieil aveugle. Peu importe d'ailleurs qu'un vieil aveugle fasse un travail critique sur un film (allant jusqu'à donner son point de "vue" sur certains cadrages), puisqu'il n'a sans doute jamais été tourné...
Seule importe la
maison, dont l'impossible réalité devient bien tangible, tout comme se matérialisent dans la vie de Johnny les conséquences nocives de son étude prolongée et monomaniaque du manuscrit chargé de ratures et de sens de son étrange voisin défunt. Partout la noirceur fait tâche d'huile et s'étend, et ce lacis d'histoires devient un vortex, une spirale dont les multiples branches (récit de Zampanò, notes-récit de Johnny, notes correctives des Editeurs -et ici, du traducteur, qui prend part au jeu-, interventions de Tom, frère de Navy, interviews de différents protagonistes ou spécialistes par Karen, après les événements, etc.) mènent toutes au coeur du mystère, dans un immense trou noir insondable et froid comme une tombe, pétrifiant de terreur. Et nul ne peut assurer qu'au coeur des ténèbres ne se cache pas le
minotaure.
La maison des feuilles, c'est l'équivalent littéraire du
Projet Blair Witch, le génie en plus.
 Mark Z. Danielewski himself
Mark Z. Danielewski himselfC'est aussi un hommage aux maîtres de Danielewski : Burroughs (pour le "cut-up" et les jeux formels)
**, Jorge Luis Borges (modèle plus ou moins évident de Zampanò), Edgar Allan Poe (
La chute de la maison Usher), mais aussi bien toute la littérature gothique européenne, Stephen King ou Heidegger. Parfois, Danielewski/Zampanò peut agacer, par son côté intello new-yorkais qui cite Deleuze ou Derrida et fait d'impressionnants name-dropping de photographes, documentaristes, architectes, etc. Pourtant, c'est cet académisme de pacotille qui est aussi raillé par le mécanisme même du récit (notes de bas de pages qui en avalent d'autres jusqu'à l'inexorable vertige...) et en premier lieu par Danielewski/Johnny, qui a toujours le dernier mot et constitue, malgré les apparences, le coeur même de ce livre, et son sujet le plus intéressant, le plus réussi aussi.
Roman expérimental mais jouissif, ardu mais plus trépidant qu'aucun Tom Clancy, méta-livre qui s'auto-génère,
La maison des feuilles est une oeuvre maline et malade, qui transporte et transforme quiconque est assez courageux pour y plonger. Il est impossible de sortir indemne de cette lecture, sans que sa noirceur intense, sa tristesse profonde ne vous ait envahi, sans que Johnny ne vous ait changé à tout jamais, comme lui-même a été changé par les mystères de Ash Tree Lane. C'est tout aussi impossible que cette foutue
maison, ne cherchez pas.
Ceci n'est pas pour vous.La maison des feuilles (
House of leaves), Mark Z. Danielewski, Denoël, "Denoël et d'ailleurs", 2002, traduction de Christophe Claro.
***Côté "actualité" (comme on dit sur les plateaux de promo) : le second roman de Danielewski,
Only Revolutions, devrait sortir fin août en France sous le titre
O Révolutions. Nouvelle tentative uber-oulipesque de ce fou furieux : narrer dans un road movie littéraire en forme de poème lyrique l'histoire de deux inséparables éternels adolescents (éternels au sens propre...) en quête d'aventures : Sam et Hailey. La particularité formelle étant cette fois-ci que le roman se lit indifféremment de chaque côté (oui, vous avez bien lu...) suivant que l'on désire suivre le point de vue et monologue de
l'un ou de
l'autre de ces personnages qui sillonnent l'Amérique et ses mythes de part en part durant deux cents ans (1863-2063). Oeuvre-limite, juchée à la frontière de l'incompréhensible et de l'art pour l'art et inspirée des défis les plus hermétiques de Joyce et Beckett. Le bébé est-il viable quand même? Réponse dans quelques semaines...
Addenda du 05/08 : 16 pages extraites de la traduction française de Claro (voir infra) sont d'ores et déjà consultables au format PDF sur
le site de Denöel. Pour ceux que cet échantillon allécherait autant que votre serviteur, rappelons que le roman paraît le 23 août prochain.
* : Merci à l'indispensable NoThanks pour ces précieuses informations. ;)
** : Deux exemples visuels qui valent plus que tous les discours :

 ***
*** : Claro, passeur émérite de ce pavé labyrinthique est un ambitieux forçat de la traduction, passionné par la "nouvelle fiction" américaine, et on lui doit aussi les versions françaises du
Courtier en tabac de John Barth ou
La famille royale de William T. Vollmann. Depuis quelques années, il codirige avec bonheur la pynchonienne collection "Lot 49" au Cherche Midi, et a ainsi permis de faire connaître nombre d'auteurs américains contemporains : Richard Powers, Ben Marcus (
Le silence selon Jane Dark) ou Brian Evenson (
Inversion). Il planche actuellement en parallèle sur deux travaux de traduction des plus complexes :
Only Revolutions et un autre gros morceau de la rentrée littéraire,
Central Europe de William T. Vollmann. Il est aussi romancier et
bloggueur. Je pense que ses journées comptent 24 heures de plus que les miennes...